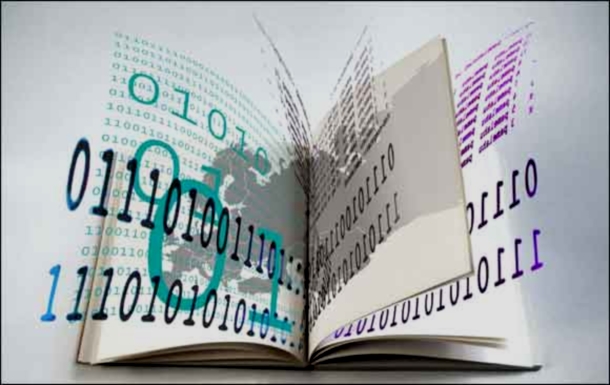Conversation avec Roger Chartier, historien, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « Écrit et cultures dans l’Europe moderne ». Roger Chartier né à Lyon, il a fait ses études secondaires au lycée Ampère de sa ville natale. Entre 1964 et 1969, il est élève à l’École normale supérieure de Saint-Cloud et en parallèle, il poursuit un cursus universitaire de licence et de maîtrise à la Sorbonne (1966-1967). En 1969, il reçoit l’agrégation d’histoire. En 1970, il devient assistant en Histoire moderne à l’université de Paris I puis maître-assistant à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il devient par la suite maître de conférences et puis directeur d’études à l’EHESS jusqu’en 2006. Dans la même année, il est nommé professeur au Collège de France. Roger Chartier anime également l’émission « Les lundis de l’Histoire » sur France Culture, au cours de laquelle il s’entretient avec des historiens qui publient des ouvrages sur l’histoire moderne. Auteur de nombreux essais, traduit dans plusieurs langues étrangères, dont « L’Éducation en France du XVIe au XVIIIe siècle» avec Marie-Madeleine Compère et Dominique Julia, Paris, Société d’édition d’enseignement supérieur, 1976 ; « Histoire de l’édition française», direction avec Henri-Jean Martin), 4 volumes (1983–1986), Paris, éditions Fayard et Cercle de la librairie, 1991; « L’Ordre des livres. Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe et XVIIIe siècle», Aix-en-Provence, éditions Alinea, coll. « De la pensée / Domaine historique »,1992 ; « Le Livre en révolutions, entretiens avec Jean Lebrun», Paris, éditions Textuel,1997; « Histoire de la lecture dans le monde occidental » direction avec Guglielmo Cavallo, 1997, réédition, Éditions du Seuil, coll. « Points / Histoire » Paris, 2001; « Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude », Paris, éditions Albin Michel, coll. « Bibliothèque Albin Michel de l’histoire », 1998; « Le sociologue et l’historien », avec Pierre Bourdieu, Marseille, éditions Agone/Raisons d’agir, coll. « Banc d’essais », 2010. L’entière conversation, recueillie par le journaliste Ivan Jablonka, a été publiée sur le site numérique http://www.viedesidees.fr , le 29 septembre 2008.
Ivan Jablonka. Je voudrais évoquer avec vous la manière dont l’objet livre se métamorphose aujourd’hui sous l’influence des technologies liées à Internet (les e-books, le print-on-demand, etc.). Pouvez-vous revenir sur quelques-unes des mutations que le livre a connues depuis l’invention du codex ?
Roger Chartier. Le premier problème, c’est : qu’est-ce qu’un livre ? C’est une question que posait Kant dans la seconde partie des Fondements de la métaphysique des moeurs, et il définissait très clairement ce qu’est un livre. D’un côté, c’est un objet produit par un travail de manufacture, quel qu’il soit – copie manuscrite, impression ou éventuellement production électronique –, et qui appartient à celui qui l’acquiert. En même temps, un livre, c’est aussi une oeuvre, un discours. Kant dit que c’est un discours adressé au public, qui est toujours la propriété de celui qui l’a composé et qui ne peut être diffusé qu’à travers le mandat qu’il donne à un libraire ou à un éditeur pour le mettre dans l’aire de la circulation publique.Tous les problèmes de la réflexion tiennent à cette relation complexe entre le livre comme objet matériel et le livre comme oeuvre intellectuelle ou esthétique, parce que, jusqu’à aujourd’hui, la relation s’est toujours établie entre ces deux catégories, entre ces deux définitions – d’un côté, des oeuvres qui ont une logique, une cohérence, une complétude et, de l’autre, les formes matérielles de leur inscription, qui pouvait être, dans l’Antiquité et jusqu’au premier siècle de notre ère, le rouleau. Dans ce cas-là, très souvent, l’oeuvre est disséminée entre plusieurs objets. À partir de l’invention du codex (c’est-à-dire du livre tel que nous le connaissons encore, avec des cahiers, des feuillets et des pages), une situation inverse apparaît : un même codex pouvait, et c’était même la règle, contenir différents livres au sens d’oeuvre. La nouveauté du présent, c’est que cette relation entre des classes d’objets et des types de discours se trouve brisée, puisqu’il y a une continuité textuelle qui est donnée à lire sur l’écran et que l’inscription matérielle sur cette surface illimitée ne correspond plus à des types d’objet (les rouleaux de l’Antiquité, les codex manuscrits ou le livre imprimé à partir de Gutenberg). Ceci entraîne des discussions qui peuvent avoir des aspects juridiques, sur le plan du droit ou de la propriété. Comment maintient-on les catégories de propriété sur une oeuvre, à l’intérieur d’une technique qui ne délimite plus l’oeuvre comme le faisait l’objet, le rouleau ancien ou le codex ? Ceci peut aussi avoir des conséquences sur la reconnaissance des statuts d’autorité scientifique. À l’époque du codex, une hiérarchie des objets pouvait indiquer plus ou moins une hiérarchie dans la validité des discours. Il y avait une différence immédiatement perceptible entre l’encyclopédie, le livre, le journal, la revue, la fiche, la lettre, etc., qui étaient matériellement donnés à lire, à voir, à manier, et qui correspondaient à des registres de discours qui s’inscrivaient dans cette pluralité de formes. Or, aujourd’hui, le seul objet – il y en a un sur ce bureau – est l’ordinateur, qui porte tous les types de discours, quels qu’ils soient, et qui rend absolument immédiate la continuité entre les lectures et l’écriture. On peut alors entrer dans les réflexions contemporaines, mais en revenant à cette dualité que l’on oublie souvent. Le problème du livre électronique se trouve posé, avec une rematérialisation dans un ordre d’objets, tels que l’e-book ou l’ordinateur portable, qui sont des objets uniques pour toutes les classes de textes. À partir de là, la relation est posée dans des termes nouveaux.
Ivan Jablonka. Michel de Certeau établit une distinction entre la trace écrite, fixée et durable, et la lecture, qui est de l’ordre de l’éphémère1. Mais, sur Internet, les textes ne cessent de muter et de se transformer. En exagérant un peu, on pourrait dire qu’Internet est un univers de « plagiaires plagiés ». Est-ce selon vous une rupture, ou diriez-vous qu’au cours de l’histoire, et notamment au XVIIe siècle, le texte n’a jamais été une forme stable ?
Roger Chartier. Oui. Dans sa distinction, Michel de Certeau renvoie au lecteur voyageur, qui construit de la signification à partir de contraintes, en même temps qu’il la construit à partir de libertés, c’est-à-dire qui « braconne ». Si l’on braconne, c’est parce qu’il y a un territoire qui est protégé, interdit et fixé. De Certeau comparait souvent l’écriture au labour et la lecture au voyage (ou au braconnage). Effectivement, c’est une vision qui a pu inspirer les travaux sur l’histoire de la lecture ou la sociologie et l’anthropologie de la lecture, à partir du moment où la lecture n’était plus enfermée dans le texte, mais était le produit d’une relation dynamique, dialectique, entre un lecteur, ses horizons d’attente, ses compétences, ses intérêts, et le texte dont il s’empare. Mais cette distinction productrice peut aussi masquer deux éléments. Le premier, c’est que ce lecteur braconnier est lui-même assez strictement déterminé par des déterminations collectives, partagé par des communautés d’interprétation ou des communautés de lecture, et donc que cette liberté créatrice, cette consommation qui est production, a ses propres limites ; elle est socialement différentielle. Deuxièmement, comme vous le dites, ce terrain du texte est un terrain plus mobile que celui d’une parcelle de champ, dans la mesure où, pour de multiples raisons, cette mobilité existait. Les conditions techniques de reproduction des textes, par exemple la copie manuscrite (qui a existé jusqu’aux XVIIIe ou XIXe siècles), sont ouvertes à cette mobilité du texte, d’une copie à l’autre. Sauf pour des textes très fortement marqués de sacralité, où la lettre doit être respectée, tous les textes sont ouverts à des interprétations, des additions, des mutations. À la première époque de l’imprimerie, c’est-à-dire entre le milieu du XVe siècle et le début du XIXe siècle, pour des raisons multiples, les tirages sont toujours très restreints, entre 1 000 et 1 500 exemplaires. À partir de ce moment-là, le succès d’une oeuvre est assuré par la multiplicité des rééditions. Et chaque réédition est une réinterprétation du texte, soit dans sa lettre, modifiable, soit même dans ses dispositifs matériels de présentation qui sont une autre forme de variation. À supposer même qu’un texte ne change pas d’une virgule, la modification de ses formes de publication – caractères typographiques, présence ou non de l’image, divisions du texte, etc. – crée une mobilité dans les possibilités de l’appropriation. On a donc de puissantes raisons pour affirmer cette mobilité des textes. Il y en a d’autres, qui sont intellectuelles ou esthétiques : jusqu’au romantisme, les histoires appartiennent à tout le monde et les textes s’écrivent à partir de formules déjà là. Cette malléabilité des histoires, cette pluralité des ressources disponibles pour l’écriture, crée une autre forme de mouvement, impossible à enfermer dans la lettre d’un texte qui serait stable à tout jamais. Et l’on pourrait même ajouter que le copyright ne fait que renforcer cette donnée. C’est bien sûr paradoxal, puisque le copyright reconnaît que l’oeuvre est toujours identique à elle-même. Mais qu’est-ce que le copyright protège ? Au XVIIIe et au XIXe siècle, il protège toutes les formes possibles de publication imprimée du texte et, aujourd’hui, toutes les formes possibles de publication du texte, que ce soit une adaptation cinématographique, un programme de télévision ou de multiples éditions. On a donc un principe d’unité juridique qui couvre justement la pluralité indéfinie des états successifs ou simultanés de l’oeuvre. Je pense qu’il faut resituer la mobilité du contemporain, avec le texte électronique, ce texte palimpseste et polyphonique, dans une conception de longue durée sur des mobilités textuelles qui lui sont antérieures. Ce qui reste de la question, c’est le fait qu’il y a des tentatives constantes pour réduire cette mobilité dans le monde électronique. C’est la condition de possibilité pour que des produits soient vendables – un «opus mechanicum », comme aurait dit Kant – et c’est la condition de possibilité pour que des noms propres soient reconnaissables à la fois comme créateurs et comme bénéficiaires de la création. De là la contradiction très profonde qu’avait développée Robert Darnton entre cette mobilité infinie de la communication électronique et cet effort pour enserrer le texte électronique dans des catégories mentales ou intellectuelles, mais aussi dans des formes matérielles qui le fixent, qui le définissent, qui le transforment en une parcelle que le lecteur va peut-être braconner – mais une parcelle qui serait suffisamment stable dans ses frontières, ses limites et ses contenus. Ici se situe le grand défi, qui est de savoir si le texte électronique doit être soumis à des concepts hérités et donc du coup doit être transformé dans sa matérialité même, avec une fixité et des sécurités, ou si inversement les potentialités de cet anonymat, de cette multiplicité, de cette mobilité sans fin vont dominer les usages d’écriture et de lecture. Je crois que là se situent la discussion, les incertitudes, les vacillations contemporaines.
Ivan Jablonka. Pour terminer, cet ensemble de questions sur les mutations de l’objet livre, je voudrais aussi vous interroger sur les mutations du lieu qui enferme historiquement cet objet : la bibliothèque. Dans son programme « google.books » , Google a numérisé les livres de vingt-huit bibliothèques, parmi lesquelles celles de Harvard, Stanford et Oxford. Ce programme a des adeptes (critiques) comme Darnton et des adversaires comme Jean-Noël Jeanneney. Croyez-vous que Google va faire émerger une bibliothèque mondiale et ouverte à tous ?
Roger Chartier. Là encore, on retrouverait derrière ce projet des mythes ou des figures anciennes, en particulier une bibliothèque qui comprendrait tous les livres. C’était le projet des Ptolémées à Alexandrie. Google serait inscrit dans cette perspective de la bibliothèque qui contiendrait tous les livres déjà là ainsi que les livres que l’on pourra écrire. Techniquement et idéalement, il n’y a aucune raison de penser que tous les livres existants sous une forme ou sous une autre ne pourraient pas être numérisés et donc intégrés dans une bibliothèque universelle. Mais une des premières limites est que le projet de Google est pris en charge par une entreprise capitaliste. Il y a des logiques économiques qui le gouvernent, même si elles ne sont pas immédiatement visibles, et qui peuvent gouverner aussi les annonceurs ou les supports de cette énorme firme. D’autre part, c’est un projet qui, même s’il se prétend universel, fait la part belle à la langue anglaise. Comme le disait une ex-gouverneur du Texas, si l’anglais a été suffisant pour Jésus, il doit être suffisant pour les enfants du Texas. Elle n’avait sans doute lu la Bible que dans la traduction du roi Jacques et non pas les versions antérieures. Le projet ne se présente pas de cette façon, mais néanmoins, étant donné que les cinq premières bibliothèques choisies étaient anglo-saxonnes, la dominante des fonds était nécessairement en langue anglaise. Quelles sont alors les réponses possibles ? On a proposé que les bibliothèques nationales et européennes puissent s’organiser de façon à avoir un projet alternatif. Il était alternatif en termes de variété linguistique et aussi parce qu’il était plutôt fondé sur la puissance publique, et pas sur l’entreprise privée. Mais on peut supposer que, par ces morceaux de bibliothèques universelles, on pourrait arriver à une bibliothèque universelle, même si elle n’est pas unifiée par un Ptolémée contemporain ; et il n’y a pas de raison de penser qu’elle ne pourrait pas être accessible sous une forme électronique. La question posée, à partir de là, est non seulement celle des langues et de la responsabilité, mais aussi la question de savoir si cette bibliothèque universelle, qui potentiellement ne nécessite plus aucun lieu dans la mesure où chacun avec son ordinateur, où qu’il soit, peut appeler tel ou tel titre, signe la mort des bibliothèques telles que nous les connaissions – un lieu où les livres sont conservés, classés et consultables. Je crois que la réponse est non. Le processus de numérisation plaide même encore plus fortement pour le maintien de la définition traditionnelle, parce qu’on en revient à un point toujours fondamental, celui selon lequel, comme disait Don MacKenzie, les formes affectent le sens. Le grand danger du processus de numérisation est de laisser penser qu’un texte est le même quelle que soit la forme de son support. Aussi fondamental que soit l’accès à des textes sous une forme numérique, ce qui se trouve néanmoins renforcé par cette numérisation, c’est le rôle de conservation patrimoniale des formes successives que les textes ont eues pour leurs lecteurs successifs. La tâche de conservation, de catalogage et de consultation des textes dans les formes qui ont été celles de leur circulation devient une exigence absolument fondamentale, qui renforce la dimension patrimoniale et conservatoire des bibliothèques. Les démonstrations peuvent être multiples. Au XIXe siècle, le roman existe dans de multiples formes matérielles, sous la forme de feuilletons hebdomadaires ou quotidiens dans les journaux, sous la forme de publications par livraisons, sous la forme de livres pour les cabinets de lecture, sous la forme d’anthologies d’un seul auteur ou d’oeuvres diverses, sous la forme d’oeuvres complètes, etc. Chaque forme de publication induit des possibilités d’appropriation, des types d’horizon d’attente, des relations temporelles avec le texte. La nécessité de renforcer ce rôle de conservation des patrimoines écrits est non seulement bonne pour les érudits qui voudraient reconstruire l’histoire des textes, mais aussi pour la relation que les sociétés contemporaines entretiennent avec leur propre passé, c’est-à-dire avec les formes successives que la culture écrite a prises dans le passé. La plus grande discussion autour des projets comme ceux de Google, imités ensuite par des consortiums de bibliothèques, se tient là. Lorsqu’ils ont appris l’existence du projet de Google, certains conservateurs de bibliothèques en ont conclu qu’ils allaient pouvoir vider les magasins et réaffecter les salles de lecture. On le voit aussi avec la controverse qui fait rage aux États-Unis sur les destructions de journaux du XIXe et du XXe siècle, dès lors qu’ils ont été reproduits sur un substitut, en l’occurrence le microfilm ; mais le risque serait encore plus fort avec la numérisation. Les bibliothèques ont vendu leurs collections, ou bien elles ont été détruites au cours du processus de microfilmage. Un romancier américain, Nicholson Baker, a écrit un livre pour dénoncer cette politique qui a été celle de la Library of Congress et celle de la British Library, et d’ailleurs pour tenter lui-même de sauver ce patrimoine écrit, puisqu’il a constitué une sorte d’archive des collections de journaux quotidiens américains des années 1850 jusqu’à 1950.
Ivan Jablonka
* L’entière conversation, recueillie par le journaliste Ivan Jablonka, peut être lue sur le site numérique http://www.viedesidees.fr